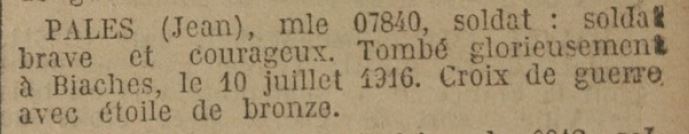Jean PALES est né le 4 mars 1887 à Argelès sur Mer dans le département des Pyrénées-Orientales. Il est incorporé à la classe 1907, sous le numéro 29 dans l’ordre du tableau de recensement cantonal et est pris bon pour le service armé en 1908 suivant la décision du conseil de révision à Argelès sur Mer le 19 mars 1908.
Il est décrit par le registre matricule sous le numéro 332 comme ayant les cheveux et les sourcils châtain clair, les yeux châtain foncé, le front découvert, le nez et la bouche moyen, le menton rond et le visage ovale ; d’une taille de 1,55 mètre et du degré deux d’instruction. C’est à dire, sachant lire et écrire sans certificat d’instruction primaire.
De l’incorporation au 4e Zouaves aux campagnes de Tunisie et du Maroc :
Il est incorporé au 4 e régiment de zouaves à compter du 8 octobre 1908. Venant de la 16 e région militaire de Montpellier, Jean prend le bateau à Marseille pour Bizerte rejoindre le dépôt du 7 e bataillon du 4 e Zouaves, à la caserne Saussier à Tunis.
Il arrive au corps des zouaves comme zouave de 2e classe le 10 octobre 1908 sous le matricule 17281 au sein du 19 e Corps d’Armée. Ayant acquis son certificat de bonne conduite, il participe aux campagnes de Tunisie du 9 octobre 1908 au 4 août 1909. La division d’occupation de la Tunisie, commandée par le général Vérand, comprend deux brigades. Le 4 e régiment de zouaves appartient à la 1 ère brigade. Il est affecté à la caserne Saussier à Tunis qui héberge l’état-major et les 3 e , 4 e et 6 e bataillons. Jean Pales est nommé zouave de 1 ère classe le 6 août 1910. Le 4 e zouaves est aussi sollicité pour des opérations militaires dans la région de Casablanca au Maroc du 5 août 1909 au 26 septembre 1910.
A Rabat, le commandant en chef des troupes du Maroc et commandant des troupes du Maroc Occidental est le général Lyautey. Quant aux troupes du Maroc Oriental, elles sont placées sous le commandement du général Baumgarten.
Deux bataillons du 4 e régiment de zouaves participent à la constitution de l’armée du Maroc Occidental.
Puis, il est rendu à sa vie familiale en passant dans la disponibilité de l’armée active le 25 septembre 1910 et est affecté au 24e régiment d’infanterie coloniale caserné à Perpignan.
Quelques mois plus tard, Jean épouse Rose AUGE, fille d’un propriétaire terrien le 25 février 1911 à Cabestany, petit village viticole de quelques centaines d’habitants, au sud est de la capitale départementale.
Le jeune marié s’occupe des vignes de ses beaux-parents et n’oublie pas de leur faire un beau garçon : François, né le 25 mai 1912.
De la Mobilisation à la bataille des Frontières :
Le soldat Pales est rappelé à l’activité militaire en vertu de l’ordre de mobilisation générale du 1 er août 1914. Il rejoint le corps le 3 août et prend le matricule 1084. Il rejoint la caserne Saint Martin à Perpignan.
Le régiment s’embarque les 9 et 10 août au milieu d’un enthousiasme indescriptible.
La population civile se presse dans la cour de la gare et déborde sur les quais acclamant le régiment au départ : une gerbe, sur les quais, est offerte au colonel BETHOUARD
Les trains qui emportent les bataillons vers la frontière s’ébranlent aux accents de la Marseillaise, chantée par des milliers de voix.
Après un trajet de 36 heures, le régiment débarque à Revigny, situé dans le département de la Meuse, va occuper Noyer et Nettencourt d’où il est dirigé par étapes sur la Belgique. Le 24 e Régiment d’Infanterie Coloniale pénètre en Belgique le 22 août et entre dans Jamoigne vers 16 heures. La bataille a déjà commencé à l’Est de Jamoignes et le 22 e R.I.C. qui précédait le 24 e est aux prises avec l’ennemi.
Le 21 août, le Corps d’Armée Colonial groupé dans la région de Stenay (Meuse), reçoit l’ordre de prendre l’offensive sur tout son front en direction générale de Neufchâteau et d’attaquer l’ennemi partout où il le rencontrera.
La situation est grave : la 3 e Division Coloniale, avancée hardiment en direction de Neufchâteau, a été surprise dès le passage de la Semoy par l’ennemi, qui, depuis huit jours, organisait dans le plus grand secret les lisières de bois au nord de la rivière.
Bientôt le Corps d’Armée en entier est engagé dans une lutte acharnée qui se prolonge jusqu’au lendemain soir.
Le 24 e , resté d’abord en réserve à Jamoignes, a pour mission d’organiser, dans la nuit du 22 au 23, la défense du village des Bulles formant tête de pont au-delà de la Semoy en avant de Jamoignes.
L’attaque allemande sur les Bulles se déclenche le 23 août à 8 heures, elle est précédée et accompagnée d’un très violent tir d’artillerie qui, dirigé à faible distance sur nos troupes, insuffisamment protégées par des tranchées à peine ébauchées, nous cause de grosses pertes ; d’autre part notre artillerie ne peut intervenir sur cette partie du champ de bataille.
Dans l’après-midi, le régiment éprouvé par 6 heures de lutte (les pertes sont de 11 officiers, 550 hommes) reçoit l’ordre de reporter la défense autour du village de Moyen sur la rive gauche de la Semoy.
Avant que l’ennemi n’ait prononcé l’assaut sur la nouvelle ligne, l’ordre de retraite arrive et vers 20 heures le régiment reprend en sens inverse l’itinéraire suivi la veille.
Alors commence la longue et angoissante retraite, coupée d’arrêts brusques et de retours offensifs (combats de Jaulnay, le 27 août où le soldat Jean Pales est blessé , de Châtillon, le 31 août, de Bussy-le-Château, le 3 septembre) et qui amena le 5 septembre le régiment sur le canal de la Marne.
Après ces dix jours de marches interminables, marquées de trop courts repos et de durs combats (le combat de Jaulnay, coûte au régiment 9 officiers et 550 hommes, le colonel BETHOUART est grièvement blessé le 31 août), une lassitude infinie se manifeste chez beaucoup ; chaque étape, qui consacrait l’abandon à l’ennemi d’une large bande de territoire, était un nouvel arrachement dans tous les coeurs.
Aussi, l’ordre de faire front et de reprendre l’offensive, fut accueilli avec un soulagement indicible, ce sera la bataille de la Marne.
La bataille de Champagne :
Le 16 septembre, le 24e , placé en réserve, va occuper le 18, après un court repos, le front : Ferme de Beauséjour – Côte 191 – tenu jusque là par trois régiments d’infanterie.
L’effectif du régiment n’est plus que de 21 officiers et 1 700 hommes.
Le 25 septembre , la situation est la suivante : le front de Beauséjour, Ruisseau de l’Etang (2 km) est tenu par un bataillon en avant-postes (Bataillon de LA GLETAIS), les deux autres bataillons, 2 e et 3 e , sont en réserve d’avant-postes à Minaucourt .
En première ligne, les compagnies à effectifs réduits, ne peuvent établir la liaison entre elles que par des patrouilles et leur situation devient de ce fait particulièrement critique pendant la nuit.
Le 26 septembre, à 4 heures, une fusillade d’une violence inouïe éclate sur tout le front du 24 e ; les mitrailleuses crépitent sans arrêt ; les bataillons en réserve sont alertés aussitôt.
Aucun renseignement ne parvient de la première ligne ; mais au point du jour, les balles arrivant sur les lisières de Minaucourt indiquent que l’ennemi occupe, du moins en partie, les crêtes de la Côte 180 à 1 800 mètres du village.
Aussitôt les deux bataillons en réserve sont lancés à l’assaut de ces crêtes ; un bataillon du 2 e R.I.C., cantonné à Minaucourt, est mis à la disposition du colonel commandant le 24 e R.I.C.
Le bataillon d’assaut de droite progresse rapidement et établit bientôt la liaison avec le 8 e R.I.C. Les Allemands sont en force sur la crête de la Côte 180 qu’ils occupent solidement.
Après une lutte acharnée et grâce à une manoeuvre hardie, ce bataillon réussit à déborder les Allemands sur le flanc gauche ; ceux-ci, tournés, décimés en grande partie, fléchissent et s’enfuient en désordre laissant entre nos mains un drapeau (69 e régiment) et plus de 300 prisonniers.
Le bataillon de gauche ne peut progresser que lentement ; les Allemands, maître de la ferme de Beauséjour, prennent d’enfilade le ruisseau de Marson et ce n’est qu’en fin de journée que grâce à la progression de la droite et à l’appui particulièrement efficace de l’artillerie, que de ce côté les lignes tenues avant l’attaque peuvent être réoccupées.
Cette journée particulièrement glorieuse pour le 24 e colonial lui coûtait 3 officiers et 470 hommes, en outre, le commandant et l’adjudant-major du bataillon du 2 e R.I.C. en réserve étaient tués aux côtés du colonel JANNOT.
Quelques jours après, le général commandant l’Armée portait à la connaissance de l’Armée le décret décernant la Légion d’Honneur au drapeau du 24 e R.I.C.
ORDRE GENERAL N° 72 DE LA 10 e ARMEE
« Le Général Commandant l’Armée est heureux de porter à la connaissance des troupes sous ses ordres l’enlèvement d’un drapeau du 69 e régiment d’infanterie allemande (8 e Corps). Ce brillant fait d’armes a été accompli par le 24 eme régiment colonial au cours des combats violents qui ont été menés pendant la journée du 26 septembre sur le front de la 4 e Armée, combats au cours desquels l’ennemi a subi des pertes considérables et abandonné entre nos mains de nombreux prisonniers. Cette prise fait le plus grand honneur au 24 eme régiment d’infanterie coloniale et est de nature à rehausser encore si possible la brillante réputation de ce régiment. »
Le Général Commandant l’Armée.
Signé LANGLE DE GARY
Le 22 octobre, la Croix de la Légion d’Honneur était épinglée au Drapeau par le Général Commandant l’Armée en présence de détachements de tous les régiments du Corps d’Armée, groupés autour du monument de Valmy. Cet honneur insigne était la plus juste récompense des hauts faits du régiment qui, en un mois de campagne, avait perdu dans des combats presque quotidiens 44 officiers et plus de 2 900 hommes, équivalent à peu de choses près à l’effectif de départ.
En outre, une Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur, 11 Médailles Militaires et 12 Citations à l’Ordre de l’Armée sont accordées.
Après le combat du 26 septembre, le régiment est réduit à deux bataillons.
Après avoir vainement tenté, le 26, de reprendre l’offensive, les Allemands se terrent et, devant le front du régiment, la première ligne ennemie est bientôt sillonnée de tranchées et de boyaux.
Le même travail s’effectue du côté français, mais plus lentement d’abord ; il semble que l’on se résigne plus difficilement à se terrer, tant l’espoir de reprendre l’offensive est vivace.
Peu à peu, de part et d’autre, le travail de sape commence ; les lignes viennent presque au contact en certains endroits ; sur la côte 191 une guerre de mines, bientôt très active, prend naissance : c’est la guerre de position qui succède définitivement à la guerre de mouvement.
Notre ligne est restée telle qu’elle était après le combat du 26 septembre, elle part de la ferme de Beauséjour, suit les pentes nord de la crête du Calvaire et de la côte 180, puis se dirigeant brusquement au nord, traverse le ruisseau de l’Etang pour tourner ensuite vers l’est en englobant le col dit des Abeilles et la côte 181.
Sauf quelques modifications légères, le 24 e occupera jusqu’à la fin de 1914 le secteur comprenant le mamelon de la côte 180 et le front du ruisseau de l’Etang, et aura, d’une façon générale, à partir du 23 octobre, date de la reconstitution du 1er bataillon, un bataillon en première ligne, un bataillon en deuxieme ligne et un bataillon au repos à Courtemont, village situé à 4 kilomètres de la première ligne.
Le soldat PALES rejoint le front le 7 décembre 1914.
La région occupée par la 2 e D.I.C. (la ferme de Beauséjour et la Main de Massiges seront bientôt célèbres), présente bien peu de confort pour les troupes : c’est la Champagne Pouilleuse avec son sol crayeux et aride que les premières pluies ont tôt fait de transformer en cloaque et sur lequel les tranchées et boyaux ressortent vivement en grosses lignes blanches entrecroisées qu’aucune herbe ne vient jamais recouvrir.
Les villages peu peuplés, composés en grande partie de granges construites en pisé, bientôt à moitié démolies et ouvertes à tous les vents, offrent de bien faibles ressources aux unités venant au repos.
Jusqu’au 20 décembre, le régiment ne subit que des pertes légères.
Le général GAUDRELIER, commandant la 6 e brigade, est tué d’une balle à la tête, le 30 novembre, aux abords du Calvaire. Le colonel MAZILLIER prend le commandement de la brigade.
Les attaques des 20 et 28 décembre, menées l’une sur le Calvaire de Beauséjour par la 6 e brigade, l’autre sur le col des Abeilles par la 4 e brigade, entraînent des pertes plus sérieuses pour le 24 e R.I.C. A la suite de l’attaque du 20 décembre, les Allemands ont été refoulés du Calvaire de Beauséjour et se sont repliés au nord du ruisseau de l’Etang.
Le 29 décembre, le secteur de la 6 e brigade est resserré et n’est plus tenu que par un régiment ; l’autre régiment, au repos, est cantonné à Hans.
A la date du 1er janvier 1915, le régiment à perdu 47 officiers et 3 000 hommes ; il a reçu en renfort 29 officiers et 2 900 hommes.
Au cours du mois de janvier, aucun changement dans le mode d’occupation du secteur ; les travaux d’organisation sont vivement poussés ; la surveillance en première ligne est toujours très active, de nombreuses reconnaissances et patrouilles, rompant la monotonie de la vie de secteur, préparent les hommes aux opérations et sont souvent l’occasion d’actions d’éclat : « au cours d’une patrouille audacieuse faite au milieu du jour, dans le but de reconnaître un point important de la ligne ennemie, situé à 500 mètres de nos lignes, le sergent-major BERNADACH, laissant sa patrouille à la lisière d’un bois, s’avance seul jusqu’aux fils de fer ennemis, les franchit et apparaissant, révolver au poing, sur le parapet ennemi, met en fuite les guetteurs allemands, surpris par tant d’audace, repère l’emplacement d’une mitrailleuse, puis rejoint, sous une pluie de balles, sa patrouille et rentre indemne dans nos lignes ».
Le 23 janvier, le général GOURAUD prend le commandement du Corps d’Armée Colonial, le général MAZILLIER et le colonel SADORGE prennent respectivement ceux de la 2 e DIC et de la 6 e BIC. Depuis le mois d’octobre, le régiment a reçu 1 Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur, 10 Médailles Militaires, 3 Citations à l’Ordre de l’Armée.
Au début de février, la physionomie du secteur, généralement calme, va changer brusquement : depuis quelques jours, à gauche les attaques du 1 er C.A en direction de la Butte du Mesnil sont incessantes, l’ennemi oppose une résistance acharnée : la canonnade d’une violence inouïe jusque-là, ne s’interrompt, ni jour, ni nuit.
A droite, sur la côte 191 , autour de laquelle se poursuit depuis de longs mois une guerre très active, les Allemands font exploser, le 3 février à 11 heures, trois gigantesques fourneaux de mine et s’élancent à l’assaut des positions tenues par le 21 e R.I.C. : ils s’emparent des tranchées de première ligne sur une largeur de 500 mètres.
L’attaque allemande s’étend ensuite jusqu’à la droite du 24 e au nord du ruisseau de l’Etang ; elle est repoussée en ce point grâce à l’intervention audacieuse du sergent MAROT, commandant une section de mitrailleuses, qui n’hésite pas à placer ses pièces hors de la tranchée pour arrêter les assaillants.
Deux compagnies du 24 e R.I.C. sont renvoyées en renfort à la 4 e B.I.C. et participent à plusieurs contre-attaques infructueuses.
Après six jours de lutte, le général commandant le C.A.C. donne, le 10 février, l’ordre d’évacuer nos positions de 1914. La nouvelle ligne passe par le mamelon de la côte 180 et les lisières nord de Massiges. Les pertes du 24 e ont été de 2 officiers et 160 hommes
Le 11, le lieutenant-colonel JANNOT est blessé ; évacué, il ne reprendra le commandement du régiment que le 8 mars.
Le soldat Pales, blessé à nouveau, après un premier pansement au poste de secours ou dans les ambulances du front, est évacué par le train sanitaire sur l’hôpital de Chalons-sur-marne (aujourd’hui Châlon en Champagne) du 20 janvier au 5 février 1915, puis à partir du 6 février à l’hôpital de Meung sur Loire.
Après son hospitalisation, le soldat PALES obtient une permission qui lui permet de rejoindre sa femme et son fils à Cabestany. Durant ce séjour en pays catalan, Jean concevra son second fils Jean.
Retour au Front sur les Hauts de Meuse :
Le 1 er classe Pales, numéro 89 au contrôle spécial, devient le matricule 07840 et est incorporé à la 2 e compagnie du 44 e régiment d’infanterie coloniale le 20 juillet 1915.
(En effet, tous les régiments d’infanterie coloniale avait été doublés, ainsi au 24 e RIC avait été associé le 44 e RIC).
La compagnie quitte Toul (Meurthe et Moselle) et Gondreville le 27 pour rejoindre Villers-en-Haye le 30 juillet. S’en suit 3 jours de première ligne à la forêt du bois le prêtre , entre Fey-en-Haye et le bois communal de Pont-à-Mousson . Après douze jours de repos à l’arrière à Liverdun (Meurthe et Moselle), la 18 e compagnie retourne 8 jours dans la tranchée de première ligne au carrefour du bois le prêtre jusqu’au 30 août . C’est la grande vogue des engins de tranchées, les périodes d’agitation causées par les fréquents coups de main réciproques. La 2 e compagnie du 44 e colonial prend le n°18 à compter du 1 er septembre, Sous lieutenant C.Berrère. Jean est envoyé avec ses camarades à Fey-en-Haye jusqu’au 11 septembre.
Il se rend successivement à Griscourt du 12 au 17 septembre, de l’autre côté de l’Esch ou se trouve Villers-en-Haye, Foug le 18 septembre où la journée est superbement ensoleillée, en traversant le canal de la Marne au Rhin. Le 21 septembre, sa compagnie arrive à Naives en Blois. Le matin du 22 septembre est très froid, avec de la gelée blanche et du vent qui soulève la poussière de craie de Champagne et rend la visibilité nulle. Du 22 au 25 septembre, sa compagnie cantonne à Willeroncourt puis embarquer en train pour Ligny-en-Bavarrois le 26 septembre 1915. Une nuit de bivouac à Les Maigneux (nord ouest de Perthes), devant le moulin de Valmy, avant de relever pour 10 jours la première ligne à droite de Somme-Py , au nord de la butte de Tahure .
De nouveau sur le Front en Champagne :

Il trouve un secteur complètement bouleversé par notre préparation d’artillerie et arraché à l’ennemi par les corps d’attaque. Les hommes sont à découvert.
Il reçoit l’ordre de tenir coûte que coûte, malgré le tir très intense de l’artillerie, le feu violent de mousqueterie et les rafales de mitrailleuses. Le 44 e remplit sa mission sans défaillance.
Le 6 octobre, il est chargé d’une opération délicate : l’enlèvement d’un saillant des lignes ennemies. Les 23 e et 14 e Compagnies sautent résolument le parapet et, malgré les nombreux vides dans la vague d’assaut, atteignent les fils de fer allemands.
Le réseau est intact et les mitrailleurs ennemis s’acharnent sur ces objectifs par trop faciles ; les 22 e et 19 e Compagnies ne sont pas plus heureuses et regagnent dans la nuit les points de départ.
Du 8 au 11 octobre, sa compagnie rejoint le Camp Hevverfeld, et du 12 au 16, Cabanne et Puit. Il est les 17 et 18 octobre à Croix en Champagne et du 19 au 25 octobre à Ante.
Du 26 au 31 octobre , la compagnie du soldat PALES cantonne aux Cases canadiennes bois d’Hauzy. Il est, du 1 er au 8 novembre, à l’ouvrage Pruneau (poste 13). La compagnie du 9 au 11 novembre se trouve à la Chameresse et du 12 au 16 novembre au Vallon des Pins.
Du 17 au 22 novembre, la compagnie du soldat PALES prend position à l’ Index de la main de Massiges.
Son rôle offensif est momentanément terminé. Dur calvaire pour le 44 e , 60 jours de travail sans répit. Il aménage le secteur dès son arrivée, et, dans un sol bouleversé par les attaques de septembre, il crée de toutes pièces une organisation forte : tranchées solides, protégées par de larges réseaux, boyaux profonds, abris confortables. Œuvre éphémère !
La pluie d’abord, le dégel ensuite réduisent à néant le fruit de ces longues journées de labeur.
L’eau s’infiltre, les parapets s’effritent, puis de gros blocs se détachent, et par endroits, parapets et parados, insensiblement attirés l’un vers l’autre, se rejoignent et comblent la tranchée.
La nuit, les travailleurs rétablissent le passage, consolident les parois, le secteur reprend tournure mais le dégel a tôt fait de lui donner à nouveau un aspect lamentable.
C’est un vaste cloaque où la sentinelle patauge pour surveiller l’ennemi très nerveux, où les hommes s’enlisent pour porter le ravitaillement.
Malgré cette perspective de démolition rapide, le régiment recommence sans cesse les travaux voués à la destruction. Il surmonte les difficultés et donne une preuve de ténacité et d’entrain.
Du 23 au 28 novembre retour au vallon des Pins avant de reprendre position du 29 novembre au 22 décembre en 1 ère ligne au Vallon des Pins .
Départ pour la bataille de la Somme :
Ils se reposent à Valmy le 23 décembre après 24 jours de tranchées, puis à Epense la veille de Noël. Le 29 décembre la compagnie embarque à Juéry en Argonne pour arriver le 30 à Moyenneville où elle embarque pour Wacquemoulin, dans l’Oise, en suivant l’Aisne et y restera jusqu’au 18 janvier 1916. Ce jour à 7 heures du matin la compagnie quitte Wacquemoulin pour cantonner successivement à Avecs, qu’elle quitte le 19 à 07h00 pour rejoindre Reuil sur Brèche. Le 26 janvier, à 9h00 départ pour cantonner à Fontaine-Bonneleau. Le 11 février à 08h30, départ pour le cantonnement de Chaussoy-Epagny. La compagnie cantonne le 15 février à Castel sur l’Avre, et enfin Mézières-en-Santerre le 16 février 1916. Après deux jours, les poilus de la 18 e prennent position à 21 heures dans les tranchées à droite de Lihons (secteur du coq), près de Chaulnes. Ils resteront dans le secteur du Coq pendant 21 jours jusqu’au 31 mars 1916.
Le 21 février 1916, il est attaqué avec émission de gaz, les allemands font de longues émissions séparées par un court intervalle, la nappe envahit les tranchées, gagne les abris et l’ennemi, sûr de la mise hors de combat des occupants, certain du succès, se rue sur les tranchées. Mais le 44 e se défend et seuls quelques allemands prennent pied. Une énergique contre-attaque de la section GUITTARD (24 e Cie) les rejette et fait complètement échouer les efforts de l’ennemi. Après cet échec, ce dernier se montre peu actif.
Le 1 er avril, la compagnie est chargée de protéger le secteur de Hallu quinze jours durant et prend position aux tranchées à droite de Lihons (secteur de Hallu).
Après un bref repos à Méharicourt de 6 jours, du 21 avril au 31 mai, la compagnie retourne aux tranchées à droite de Lihons dont 16 jours en première ligne et 6 jours en ligne de soutien.
Le régiment recommence l’organisation du secteur qu’il ne quittera que le 29 mai pour aller se préparer à la bataille de la Somme.
Le 44e tente le 6 mai un coup de main sur le saillant de la Maisonnette (voie ferrée Rosières-Nesle ). Un bombardement intense de tous calibres précède le déclenchement. Tranchées et boyaux sont nivelés, les défenseurs tués ou blessés. Au sud, l’avance ennemie est enrayée par les mitrailleuses, au nord, les allemands favorisés par la fumée des obus, pénètrent dans les tranchées, enlèvent nos blessés et regagnent leurs lignes.
La 18 e compagnie se repose en cantonnant à Morceleaix le 31 mai, Berry sur Noye le 1 er juin. La compagnie arrive le 2 juin à Luzières Hameau près de Conty ou elle séjourne jusqu’au 20 juin, où elle cantonne à Oresmaux avant de repartir le lendemain pour le bois du Hamel, où elle bivouaque pendant un jour pour aller prendre les tranchées au sud de Cappy sur la Somme près de Bray. Relevée le 26 au matin par le 36 e colonial, elle revient au bois du Hamel. La compagnie se met en route le 28 juin pour le ravin de Morcourt où elle bivouaque le 1 er juillet.
Au soir du 1 er juillet débute l’offensive de Joffre et de Foch qui dure jusqu’au 11 novembre 1916. Le 6 e corps d’armée Fayolle, auquel appartient le 1 er CAC, fait face au groupement de Von Grosler au Nord de Péronne et au groupement de Von Quast au Sud.
Le 3 juillet, la compagnie bivouaque au camp 52 arrière Ployart et le 4 juillet au camp d’Exbroyat. Le 5 juillet, la compagnie prend les tranchées en avant d’Herbécourt jusqu’au 9 au matin. Le 8 juillet, le 37 e colonial attaque le château de la Maisonnette (doc 13), face à Péronne. Le 5 e bataillon (commandant THOLLON) est mis à la disposition du commandant du 37 e RIC.
Le 9 juillet, la compagnie prend les tranchées d’Haucourt ou elle repart à 15 heures pour aller maintenir les positions conquises à la maisonnette de Biaches. Les allemands défendent énergiquement cette importante position qui est enfin enlevée le 9 au soir, et occupée dans la nuit du 9 au 10 par la 18 e Cie du 44 e RIC.
Le lendemain, les allemands tentent de reprendre l’objectif ravi et lancent 5 attaques successives dans le secteur de la compagnie qui se défend férocement. Ainsi, le 10 juillet, à 5 heures, violemment attaquée, la compagnie repousse toutes les attaques et maintient les positions conquises. A 17 heures, elle attaque à son tour ; contre-attaquée, elle se maintient sur ses positions de départ. Le bilan de ces journées est de 72 pertes: tués, blessés et disparus ; tel est le sort de Jean Pales qui disparaît le 10 juillet lors de l’attaque des positions devant la maisonnette de Biaches.
L’ennemi veut atteindre son but et n’hésite pas à utiliser des moyens déloyaux pour forcer le succès : il fait le simulacre de ses rendre et fusille à bout portant la section du sous-lieutenant COUTURIER.
La 18 e Cie défend le terrain pied à pied, refoule l’ennemi à la baïonnette, mais devant des vagues sans cesse croissantes, elle est obligée de céder.
Elle mérite par sa conduite admirable la citation à l’ordre de l’armée :
« chargée le 18 juillet 1916 de la défense de l’important point d’appui enlevé à l’ennemi, a rempli sa mission sous le commandement énergique du lieutenant BARRERE , avec une vigueur, une ténacité et un esprit de sacrifice remarquables, repoussant à la baïonnette les contre-attaques d’un adversaire très supérieur en nombre ».
L’ordre de reprendre la Maisonnette est donné : les survivants de la 18 e Cie et trois sections de renfort de la 19 e Cie s’élancent à la conquête de l’objectif perdu quelque instants auparavant. Ils progressent malgré le bombardement et la fusillade, en dépit de l’occupation du bois Blaise par l’ennemi et atteignent la lisière est de la Maisonnette . Les allemands réagissent.
Le 44 e résiste victorieusement, mais sous la menace d’enveloppement par le nord et par le sud, il ne peut s’y maintenir et regagne les tranchées de départ.
Disparu le 10 juillet 1916 à Biaches (Avis N°3320-G2 du 2 août 1916), c’est ainsi qu’est fixée la date du décès de Jean Pales par jugement déclaratif rendu par le tribunal de Perpignan le 28 juin 1921.
Le Journal Officiel du 8 septembre 1922 publie : » PALES (Jean), mle 07840, soldat : soldat brave et courageux. Tombé glorieusement à Biaches, le 10 juillet 1916. Croix de guerre avec étoile de bronze.